Pour ceux qui cherche du taff et qui n'savent pas faire une lettre de motivation, je vous donne un petit aperçu de comment il faut s'y prendre, c'est garanti sur mesure :
Monsieur,
Depuis que j'ai 5 ans je rêve d'entrer dans la vie active. En effet, si j'ai tenu jusqu'a 22 ans avant de fournir a la société toute l'énergie vitale dont je dispose, c'était simplement parce que ma volonté de bien faire, mon esprit perfectionniste m'a conduit à étudier afin d'être ultra productif.
Mon ambition n'ayant d'égale que ma bonne volonté, je sais monsieur, que vous serez ravi de m'avoir en tant qu'employé, puisque non seulement les 4 premiers mois je ne demande aucun salaire, mais en plus je tiens à travailler environ 80 heures/semaine.
Je sais que vous pourriez être sceptique quant à ma capacité à tenir de si long mois sans rémunération, mais après une longue réflection j'en suis venu à une conclusion qui m'apparaît comme pertinente : Sachant qu'un employé de votre entreprise travaille environ 20 heures, je serai déjà 4 fois plus présent. En tenant compte du fait de ma physiologie, allié à ma volonté et de mon savoir faire, je suis également 4 fois plus productif que le meilleur de vos employé actuel. Le calcul est simple, vous aurez en m'embauchant gratuitement l'équivalent de 16 employés, ce qui, vous imaginez, vous fera faire de sérieuses économies. Au bout de 4 mois, je serai devenu incontournable dans votre société, à tel point que vous n'aurez d'autre choix que de me prendre comme adjoint.
En espérant monsieur, vous avoir convaincu, je vous prie de de considérer mon anus à votre entière disposition.
dimanche 23 septembre 2007
dimanche 9 septembre 2007
L'imagologie

Voici encore un extrait de ce cher Kundera. Je dois dire qu'il est riche d'enseignement. Un passage un peu long, mais que je vous conseille de lire.
Il est évident qu'il ne faut pas gober tout ce que raconte ce cher Milan d'une traite, et qu'étant l'extrait d'un roman plutôt dense, qu'il s'est amusé à constuire de manière à ce qu'on ne puisse pas le résumer, on ne peut comprendre que partiellement la vision qu'il dépeint de notre monde post-moderne. Mais qu'il ait tort ou raison, que ses exemples touchent ou pas, elle amorce une réflexion, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeller Guy Debord et sa société du spectacle.
Bonne lecture.
L'imagologie
L'homme politique dépend du journaliste. Mais de qui dépendent les journalistes ? De ceux qui les paient. Et ceux qui les paient, ce sont les agences de publicité qui achètent pour leurs annonces des espaces dans les journaux, ou des temps à la radio. A première vue, on pourrait croire qu'elles s'adresseront sans hésiter à tous les journaux dont la large diffusion peut promouvoir la vente d'un produit. Mais c'est une idée naïve. La vente du produit a moins d'importance qu'on ne le pense. Il suffit de considérer ce qui se passe dans les pays communistes : après tout, on ne saurait affirmer que les millions d'affiches de Lénine partout collées sur votre passage puissent vous rendre Lénine plus cher. Les agences de publicité du parti communiste (les fameuses sections d'agitation et propagande) on depuis longtemps oublié leur finalité pratique (faire aimer le système communiste) et sont devenues leur propre fin : elles ont créer un langage, des formules, une esthétique (les chefs de ces agences ont jadis été les maîtres absolu de l'art de leur pays), un style de vie particulier qu'elles ont ensuite développé, lancé et imposé aux pauvres peuples.
M'objecterez-vous que publicité et propagande n'ont pas de rapport entre elles, l'une étant au service du marché et l'autre de l'idéologie? Vous ne comprenez rien. Voilà cent ans à peu près, en Russie, les marxistes persécutés formaient de petits cercles clandestins où l'on étudiait en commune le manifeste de Marx ; ils ont simplifié le contenu de cette idéologie pour le répandre dans d'autres cercles dont les membres, simplifiant à leur tour cette simplification du simple, l'ont transmise et propagée jusqu'au moment où le marxisme, connu et puissant sur toute la planète, s'est trouvé réduit à une collection de six ou sept slogans si chétivement liés ensemble qu'on peut difficilement le tenir pour une idéologie. Et comme tout ce qui est resté de Marx ne forme plus aucun système d'idées logiques, mais seulement une suite d'images et d'emblèmes suggestifs (l'ouvrier qui sourit en tenant son marteau, le Blanc tendant la main au Jaune et au Noir, la colombe de la paix prenant son envol, etc.), on peut à juste titre parler d'une transformation progressive, générale et planétaire de l'idéologie en imagologie.
Imagologie ! Qui, le premier, a forgé ce magistral néologisme ? [...] N'importe. Ce qui compte, c'est qu'existe enfin un mot qui permette de rassembler sous un seul toit des phénomènes aux appellations si différentes : agences publicitaires ; conseiller en communication des hommes d'état ; dessinateurs projetant la ligne d'une nouvelle voiture ou l'équipement d'une salle de gymnastique ; créateurs de mode et grands couturiers ; coiffeurs ; stars du show business dictant les normes de la beauté physique, dont s'inspireront toutes les branches de l'imagologie.
Les imagologues existaient, bien entendu avant la création des puissantes institutions qu'on connaît aujourd'hui. Même Hitler a eu son imagologue personnel qui, planté devant le Führer, lui montrait patiement les gestes qu'il devait effectuer à la tribune pour susciter l'extase des foules. Mais si cet imagologue, au cours d'une interview accordée à quelque journaliste, avait décrit aux Allemands un führer incapable de bouger ses mains correctement, il n'aurait pas survécu plus d'une demi-journée à pareille indiscrétion. Aujourd'hui, l'imagologue ne dissimule pas son travail, il adore au contraire en parler, souvent aux lieu et place de son homme d'Etat ; il adore expliquer publiquement tout ce qu'il a essayé d'enseigner à son client, les mauvaises habitudes qu'il lui a fait perdre, les instructions qu'il lui a données, les slogans et les formules qu'il utilisera à l'avenir, la couleur de la cravate qu'il portera. Tant de fierté n'a rien qui doivent nous surprendre : l'imagologie a remporté, au cours des dernières décennies, une victoire historique sur l'idéologie.
Toutes les idéologies ont été vaincues : leurs dogmes ont fini par être démasqués comme illusions et les gens ont cessé de les prendre au sérieux. Par exemple, les communistes ont cru que l'évolution du capitalisme appauvrirait de plus en plus le prolétariat ; découvrant un jour que tous les ouvriers d'Europe se rendaient en voiture à leur travail, ils eurent envie de crier que la réalité avait triché. La réalité était plus forte que l'idéologie. Et c'est précisément en ce sens là que l'imagologie l'a dépassé : l'imagologie est plus forte que la réalité, laquelle d'ailleurs a depuis longtemps cessé de représenter pour l'homme ce qu'elle représentait pour ma grand-mère qui vivait dans un village morave et savait tout par expérience : comment on cuit le pain, comment on bâtit une maison, comment on tue le cochon et comment on en fait de la viande fumée, avec quoi on confectionne des édredons, ce que monsieur le curé pensait du monde et ce qu'en pensait monsieur l'instituteur ; rencontrant chaque jour tous les habitants du village, elle savait combien de meurtres avaient été commis depuis 10 ans dans la région ; elle tenait pour ainsi dire la réalité sous son contrôle personnel, de sorte que nul n'aurait pu lui faire croire que l'agriculture morave prospérait s'il n'y avait pas eu de quoi manger à la maison. A Paris, mon voisin de palier passe le plus clair de son temps assis à son bureau, en face d'un autre employé, puis il rentre à la maison, allume le téléviseur pour apprendre ce qui se passe dans le monde, et quand le présentateur, commentant le dernier sondage, l'informe que pour une majorité de Français, le France est championne d'Europe en matière de sécurité (j'ai récement lu ce sondage-là), fou de joie, il ouvre une bouteille de champagne et il n'apprendra jamais que le même jour, dans sa propre rue, ont été commis trois cambriolages et deux meutres.
Les sondages d'opinion sont l'instrument décisif du pouvoir imagologique, auquel ils permettent de vivre en parfaite harmonie avec le peuple. L'imagologue bombarde les gens de questions : comment se porte l'économie Française ? Y' a-t-il du racisme en France ? Le racisme est-il une bonne ou une mauvaise chose ? Quel est le plus grand écrivain de tous les temps ? La Hongrie est-elle en Europe ou en Polynésie ? De tous les hommes d'Etat du monde, lequel est le plus sexy ? Comme la réalité, aujourd'hui, est une continent qu'on visite peu et qu'à juste titre d'ailleurs on n'aime guère, le sondage est devenu une sorte de réalité supérieure ; ou pour le dire autrement, il est devenu la vérité. Le sondage d'opinion, c'est un parlement siégeant en permanence, qui a pour mission de produire la vérité, disons même la vérité la plus démocratique qu'on ait jamais connue. Comme il ne se trouvera jamais en contradiction avec le parlement de la vérité, le pouvoir des imagologues vivra toujours dans le vrai, et même si je sais que toute chose humaine est périssable, je ne saurais imaginer quelle force pourrait briser ce pouvoir.
A propos du rapport entre idéologie et imagologie, j'ajoute encore ceci : les idéologies étaient comme d'immenses roues, tournant en coulisse et déclanchant les guerres, les révolutions, les réformes. Les roues imagologiques tournent aussi, mais leur rotation n'a aucun effet sur l'Histoire. Les idéologies se faisaient la guerre et chacune était capable d'investir par sa pensée toute une époque. L'imagologie organise elle même l'alternance paisible de ses systèmes au rythme allègre des saisons. Comme dirait Paul (voir l'immortalité) : les idéologies appartenaient à l'Histoire, le règne de l'imagologie commence là ou l'Histoire finit.
Le mot changement, si cher à notre Europe, a pris un sens nouveau : il ne signifie plus une nouvelle phase dans une évolution continue (au sens d'un Vico, d'un Hegel ou d'un Marx), mais le déplacement d'un lieu à un autre, du côté gauche vers le côté droit, du côté droit vers l'arrière, de l'arrière vers le côté gauche (au sens des grands couturiers invantant la coupe de la prochaine saison). Dans le club que fréquente Agnès, si les imagologues avaient décidé d'installer aux murs d'immenses miroirs, ce n'était pas pour permettre aux gymnastes de mieux surveiller leurs exercices, mais parce que le miroir passait à ce moment-là pour un chiffre gagnant sur la roulette imagologique. Si tout le monde a décidé, au moment où j'écris ces lignes, qu'il faut considérer le philosophe Martin Heidegger comme un fumiste et un salaud, ce n'est pas que sa pensée ait été dépassée par d'autre philosophes, mais que, sur la roulette imagologique, il est devenu pour le moment le chiffre perdant, un anti-idéal. Les imagologues créent des systèmes d'idéaux et d'anti-idéaux, systèmes qui ne dureront guère et dont chacun sera bientôt remplacé par un autre, mais qui influent sur nos comportements, nos opinions politiques, nos goûts esthétiques, sur la couleur des tapis du salon comme sur le choix des livres, avec autant de force que les anciens systèmes des idéologues.
Après ses remarques, je peux en revenir au début de mes reflexions. L'homme politique dépend du journaliste. Et les journalistes dépendent de qui ? Des imagologues. L'imagologues est une homme à conviction et à principes : il exige du journaliste que son journal (ou sa chaîne de télévision, ou sa station de radio) répondre à l'esprit du système imagologique d'un moment donné. Voilà ce que les imagologues vérifient de temps en temps, quand ils décident d'accorder ou non leur soutien à un journal [...]
La morale
Texte non exhaustif, pamphlet contre la psychologie dont je ne savais pas encore ce que je dénoncais sur le moment, mais qui a été le début d'une réflexion ; je m'expliquerai plus tard.
La morale, c'est ce qui nous contraint dans nos libertés, ce sont les valeurs et limites qu'ont nous inculque dés notre plus tendre enfance. Par le passé, c'est la morale religieuse qui asservissait les populations, la peur de l'enfer et une vision simpliste du monde érigée à coup de vérités théologiques. Aujourd'hui, Dieu est mort; la religion n'a pas su s'adapter aux découvertes scientifiques et nombre d'hommes se sont épanouis en découvrant de nouvelles libertés. Pourtant, à mesure que l'influence de la morale religieuse s'amenuise, une morale plus insidieuse prend sa place ; La psychologie. Lorsque l'on s'écarte trop des valeurs admises ou que l'ont remet trop en cause le système, l'on s'inquiète de notre santé mentale. Quelle est la pathologie, ou est le traumatisme qui dans notre enfance nous a rendu différent?
D'un monde régit par un ordre morale, nous sommes passé à une ère ou nous sommes tous prédestinés, tous boarderlines.
L'idée de traumatismes dans l'enfance, qui conduirait à des réactions en chaine, est d'autant plus étrange qu'elle pré-suppose une évolution "normale" d'un individu, et qu'elle considère comme naturelle une évolution entre un père et une mère, dans un foyer, ce qui ne correspond à aucun critère naturel. Cette pseudo génèse n'est pas réelle, elle a été simplement considérée comme juste.
La psychologie a perdu de vu ses objectifs primaires, elle a cessé d'être un outil d'analyse médicale, pour devenir un outil essentielle à la morale, pour ne pas dire la morale elle même.
***
La morale, c'est ce qui nous contraint dans nos libertés, ce sont les valeurs et limites qu'ont nous inculque dés notre plus tendre enfance. Par le passé, c'est la morale religieuse qui asservissait les populations, la peur de l'enfer et une vision simpliste du monde érigée à coup de vérités théologiques. Aujourd'hui, Dieu est mort; la religion n'a pas su s'adapter aux découvertes scientifiques et nombre d'hommes se sont épanouis en découvrant de nouvelles libertés. Pourtant, à mesure que l'influence de la morale religieuse s'amenuise, une morale plus insidieuse prend sa place ; La psychologie. Lorsque l'on s'écarte trop des valeurs admises ou que l'ont remet trop en cause le système, l'on s'inquiète de notre santé mentale. Quelle est la pathologie, ou est le traumatisme qui dans notre enfance nous a rendu différent?
D'un monde régit par un ordre morale, nous sommes passé à une ère ou nous sommes tous prédestinés, tous boarderlines.
L'idée de traumatismes dans l'enfance, qui conduirait à des réactions en chaine, est d'autant plus étrange qu'elle pré-suppose une évolution "normale" d'un individu, et qu'elle considère comme naturelle une évolution entre un père et une mère, dans un foyer, ce qui ne correspond à aucun critère naturel. Cette pseudo génèse n'est pas réelle, elle a été simplement considérée comme juste.
La psychologie a perdu de vu ses objectifs primaires, elle a cessé d'être un outil d'analyse médicale, pour devenir un outil essentielle à la morale, pour ne pas dire la morale elle même.
Lettre de démission
Le petit truc que j'ai écris sur la thune m'a ramené quelques mois en arrière alors que je bossais chez H&M. Je leur ai envoyé une petite lettre de démission à ma façon. C'était en vain, je sais, mais ça défoule :]
Je vous prie de prendre acte de ma démission lors de la réception de cette lettre.
Les raisons qui me conduisent à rompre mon contrat sont simples : je ne cautionne pas l'immoralité et l'hypocrisie qui courrent en vos murs. Ce n'est pas comme si je ne savais pas ou je mettais les pieds en me présentant chez vous, mais je pensais pouvoir faire abstraction des défauts du métier en effectuant des tâches bêtes et méchantes, pouvant ainsi rester détacher de leur nature même. Il n'en est rien; et ce n'est pas la musique, qui bien que désagréable ne finit plus qu'en bourdonnement qui hébète, mais la manière dont vous concevez l'investissement de vos employés.
Je m'explique :
Lors de son arrivée, le nouveau est volontairement bien intégré. L'ambiance pourrait lui paraître géniale s'il oubliait son salaire misérable et l'ingratitude de ses missions. Les petits mots d'amour, les blagues entre amis et les petites collations offerte par la maison sont les petites pillules pour faire passer la sueur et les déceptions des employés motivés, qui espèrant gravir les échelons, s'intègre et adhère sans compter à la politique h&m et la reproduise avec encore plus d'entrain. La jeunesse...
Comment ne pas être touché par l'innocent qui se démène en pensant intégrer une structure pour laquelle il n'est et ne sera jamais rien? Parlez moi de sa passion et je rirai, car de ses efforts il ne connaîtra que la froide réponse de visages invisibles, planqués derrière leurs remparts de millions engrengés : "mangez bien, prenez des forces.." et encore, "bravo! 7millions, continuez.."
Plaisanterie? Assurément de mauvais goût, et il faut un cynisme avancé pour cautionner ce genre de pratiques.
Conception triste de la politique h&m, loin, bien loin de celle véhiculée dans les locaux, mais qui n'est que le masque d'une machine, une illusion qui disparaît avec la fatigue et la confrontation aux meutes presque enragées de clients, asservis eux-aussi, aux apparences, à l'envie de participer et d'être reconnu, besoin qui ne seront pas satisfait et qu'ils tentent vainement de compenser en consommant, pour votre plus grand plaisir.
En vous souhaitant une bonne continuation,
Pierre Grévin.
Je vous prie de prendre acte de ma démission lors de la réception de cette lettre.
Les raisons qui me conduisent à rompre mon contrat sont simples : je ne cautionne pas l'immoralité et l'hypocrisie qui courrent en vos murs. Ce n'est pas comme si je ne savais pas ou je mettais les pieds en me présentant chez vous, mais je pensais pouvoir faire abstraction des défauts du métier en effectuant des tâches bêtes et méchantes, pouvant ainsi rester détacher de leur nature même. Il n'en est rien; et ce n'est pas la musique, qui bien que désagréable ne finit plus qu'en bourdonnement qui hébète, mais la manière dont vous concevez l'investissement de vos employés.
Je m'explique :
Lors de son arrivée, le nouveau est volontairement bien intégré. L'ambiance pourrait lui paraître géniale s'il oubliait son salaire misérable et l'ingratitude de ses missions. Les petits mots d'amour, les blagues entre amis et les petites collations offerte par la maison sont les petites pillules pour faire passer la sueur et les déceptions des employés motivés, qui espèrant gravir les échelons, s'intègre et adhère sans compter à la politique h&m et la reproduise avec encore plus d'entrain. La jeunesse...
Comment ne pas être touché par l'innocent qui se démène en pensant intégrer une structure pour laquelle il n'est et ne sera jamais rien? Parlez moi de sa passion et je rirai, car de ses efforts il ne connaîtra que la froide réponse de visages invisibles, planqués derrière leurs remparts de millions engrengés : "mangez bien, prenez des forces.." et encore, "bravo! 7millions, continuez.."
Plaisanterie? Assurément de mauvais goût, et il faut un cynisme avancé pour cautionner ce genre de pratiques.
Conception triste de la politique h&m, loin, bien loin de celle véhiculée dans les locaux, mais qui n'est que le masque d'une machine, une illusion qui disparaît avec la fatigue et la confrontation aux meutes presque enragées de clients, asservis eux-aussi, aux apparences, à l'envie de participer et d'être reconnu, besoin qui ne seront pas satisfait et qu'ils tentent vainement de compenser en consommant, pour votre plus grand plaisir.
En vous souhaitant une bonne continuation,
Pierre Grévin.
La thune
J'aime déambuler dans rues. Sans contraintes. Fumer des cigarettes en regardant les passants. Lire un bouquin au soleil, sur les marches d'une église. J'aime d'autant plus que je suis sensé être ailleurs. J'ai encore fait l'école buissonière, je savoure les instants volés.
Je n'aime pas m'asservir. J'ai l'impression que les gens sont contents de travailler. Ca les soulage ; ils culpabilisent d'être inactif, et le jour où enfin ils passent à l'acte, libérés, ils donnent tout ce qu'ils ont. Pas tous c'est vrai. Mais j'ai cette image en tête ; ceux qui s'estiment, qui souhaitent prendre leur vie en main, qui veulent être des gens bien. Des gens normaux quoi.
J'ai entendu plusieurs fois que c'est dans la contrainte que l'on trouve sa liberté. Qu'elle nous forge. J'ai du mal à comprendre cette idée tant je la trouve abstraite. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement entre contrainte et souffrance. La liberté dans la souffrance, et je sens à plein nez les relans de notre bonne vieille religion. On travaille plus par culpabilité que par nécessité.
Si le travail n'est qu'exercice alors je travaille. Mais ça ne suffit pas à m'affranchir de cette pression coërcitive. Culpabilisante influence qui m'oblige à mettre la main à la patte et à participer aux tâches ingrates que l'on me propose. A perdre mon temps, puisqu'au final je n'apprend rien d'autre que je ne sais déjà. A fréquenter des gens incultes et bêtes. Que je ne connais pas mais dont les limites apparaissent dés les premieres moments. Leur ridicule champ de vision. L'esprit gras et bien souvent mesquins. Aux banales motivations. Vivre et puis aussi exister. Mais sans jugement critique ni originalité ; il faut alors supporter leur petit combat quotidien, leur besoin d'affirmer leur "moi", de le sublimer à coup d'attributs étriqués.
Moi c'est l'angoisse qui me travaille. Je suis un animal sauvage, appeuré, je courbe l'échine et montre des dents. Et ca leur plaît pas à mes petits chefs. Ca leur plaît pas.
Il faut s'asservir. Comme une pute. Faire semblant de jouïr, d'être docile et déjà résigné. Car il ne s'agit pas simplement de travailler : mieux vaut un lèche cul inactif qu'un rebelle motivé. Il faut montrer qu'on est heureux d'être là ; le sourire aux lèvres, l'air bienheureux dans cet environement pour ne pas, surtout, remettre en question le système dans lequels ces gens se sont installés. Rien ne les dérange plus que l'esquisse d'une crise existensielle.
Ca me fait d'ailleurs penser à une histoire de canard. Chaque matin une petite troupe de canard s'en va faire 1 km aller-retour pour aller s'abreuver au lit d'une petite rivière. Un matin, alors qu'ils s'en vont faire leur promenade quotidienne, un des membre de la tribu glisse et tombe dans un fossé. Il dévale une petite pente, et s'apperçoit que juste à coté du nid, il y a un court d'eau.
Tous les canards s'en apperçoivent et sont pris de panique, qu'on appelle chez nous crise existensielle. Résultat, plutôt que d'éviter les dangers qu'engendrent leurs parcours du combattant en s'abreuvant au pied de leurs nid, papa canard et toute la troupe décident d'ignorer cette trouvaille et de faire comme avant.
Il n'est pas bien difficile de saisir la réaction de ces gentils oiseaux. Ils conçoivent l'univers d'une certaine manière : ils ont une notion géographique du monde, des habitudes qui régulent leurs vie, et cette découverte boulverse tout ; sème le doute dans leur petite tête de palmipède. Ils découvrent l'absurde. Et rien n'est plus dur à supporter.
Il faut les comprendre : découvrir que sa vie n'a pas de sens, qu'on gaspille son énergie dans des activités qui ne nous apporte rien, à part peut-être une possibilité d'évolution sociale, est très désagréable. C'est la déprime. Le nihilisme. Chez les japonais, le suicide.
Pour en revenir au travail, j'ai éludé nombre d'arguments que l'on m'a opposé lorsque je tentais vainement de me rebeller.
Le plus courant, c'est la raison morale : le fait est que lorsqu'on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, et que ce sont les parents qui derrière doivent assurer. Je dois bien avouer que je ne vois pas très bien, face à ce coup bas, comment légitimer ma rébellion.
L'exposé qui suit est généralement plus conciliant. Il faut être stoïque : tu es compris mais la société est ainsi, il faut supporter pour plus tard, se libérer. Travaille, engrange l'argent, et fait ce qu'il te plaît.
C'est clair comme de l'eau de roche, on me demande de coucher. Moi qui rêvait d'être un preux, un chevalier dandy, un gentilhomme aux valeurs éternelles, on ne me donne d'autres alternatives que d'aller fréquenter des milieux dans lesquelles je n'aurai d'autres choix que de mentir, de me plier à des raisonnements que je n'approuve pas tout en ayant l'air d'être d'accord. Quoi de plus cynique et de plus immoral?
Quant à l'idée d'engranger de l'argent, il faut être none pour réussir à économiser en étant smicard.
Je finirai par là : évidement le travail et donc la contrainte peuvent être bénéfique puisqu'elle oblige l'homme à se surpasser, et donc à s'élever. Mais chercher la souffrance pour avancer n'est rien d'autre que du masochisme : avoir une bite dans le cul ça fait mal mais ça fait pas marcher droit.
Laissez nous vivre nous les jeunes ou bientôt on vous l'incendiera votre pays de merde.
Et une petite citation de nietzsche, tiré des apologistes du travail :
Dans la glorification du «travail», dans les infatigables discours sur la «bénédiction» du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous : à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent aujourd'hui, à la vue du travail — on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir —, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l'amour et à la haine, il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité : et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême.
na.
Je n'aime pas m'asservir. J'ai l'impression que les gens sont contents de travailler. Ca les soulage ; ils culpabilisent d'être inactif, et le jour où enfin ils passent à l'acte, libérés, ils donnent tout ce qu'ils ont. Pas tous c'est vrai. Mais j'ai cette image en tête ; ceux qui s'estiment, qui souhaitent prendre leur vie en main, qui veulent être des gens bien. Des gens normaux quoi.
J'ai entendu plusieurs fois que c'est dans la contrainte que l'on trouve sa liberté. Qu'elle nous forge. J'ai du mal à comprendre cette idée tant je la trouve abstraite. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement entre contrainte et souffrance. La liberté dans la souffrance, et je sens à plein nez les relans de notre bonne vieille religion. On travaille plus par culpabilité que par nécessité.
Si le travail n'est qu'exercice alors je travaille. Mais ça ne suffit pas à m'affranchir de cette pression coërcitive. Culpabilisante influence qui m'oblige à mettre la main à la patte et à participer aux tâches ingrates que l'on me propose. A perdre mon temps, puisqu'au final je n'apprend rien d'autre que je ne sais déjà. A fréquenter des gens incultes et bêtes. Que je ne connais pas mais dont les limites apparaissent dés les premieres moments. Leur ridicule champ de vision. L'esprit gras et bien souvent mesquins. Aux banales motivations. Vivre et puis aussi exister. Mais sans jugement critique ni originalité ; il faut alors supporter leur petit combat quotidien, leur besoin d'affirmer leur "moi", de le sublimer à coup d'attributs étriqués.
Moi c'est l'angoisse qui me travaille. Je suis un animal sauvage, appeuré, je courbe l'échine et montre des dents. Et ca leur plaît pas à mes petits chefs. Ca leur plaît pas.
Il faut s'asservir. Comme une pute. Faire semblant de jouïr, d'être docile et déjà résigné. Car il ne s'agit pas simplement de travailler : mieux vaut un lèche cul inactif qu'un rebelle motivé. Il faut montrer qu'on est heureux d'être là ; le sourire aux lèvres, l'air bienheureux dans cet environement pour ne pas, surtout, remettre en question le système dans lequels ces gens se sont installés. Rien ne les dérange plus que l'esquisse d'une crise existensielle.
Ca me fait d'ailleurs penser à une histoire de canard. Chaque matin une petite troupe de canard s'en va faire 1 km aller-retour pour aller s'abreuver au lit d'une petite rivière. Un matin, alors qu'ils s'en vont faire leur promenade quotidienne, un des membre de la tribu glisse et tombe dans un fossé. Il dévale une petite pente, et s'apperçoit que juste à coté du nid, il y a un court d'eau.
Tous les canards s'en apperçoivent et sont pris de panique, qu'on appelle chez nous crise existensielle. Résultat, plutôt que d'éviter les dangers qu'engendrent leurs parcours du combattant en s'abreuvant au pied de leurs nid, papa canard et toute la troupe décident d'ignorer cette trouvaille et de faire comme avant.
Il n'est pas bien difficile de saisir la réaction de ces gentils oiseaux. Ils conçoivent l'univers d'une certaine manière : ils ont une notion géographique du monde, des habitudes qui régulent leurs vie, et cette découverte boulverse tout ; sème le doute dans leur petite tête de palmipède. Ils découvrent l'absurde. Et rien n'est plus dur à supporter.
Il faut les comprendre : découvrir que sa vie n'a pas de sens, qu'on gaspille son énergie dans des activités qui ne nous apporte rien, à part peut-être une possibilité d'évolution sociale, est très désagréable. C'est la déprime. Le nihilisme. Chez les japonais, le suicide.
Pour en revenir au travail, j'ai éludé nombre d'arguments que l'on m'a opposé lorsque je tentais vainement de me rebeller.
Le plus courant, c'est la raison morale : le fait est que lorsqu'on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, et que ce sont les parents qui derrière doivent assurer. Je dois bien avouer que je ne vois pas très bien, face à ce coup bas, comment légitimer ma rébellion.
L'exposé qui suit est généralement plus conciliant. Il faut être stoïque : tu es compris mais la société est ainsi, il faut supporter pour plus tard, se libérer. Travaille, engrange l'argent, et fait ce qu'il te plaît.
C'est clair comme de l'eau de roche, on me demande de coucher. Moi qui rêvait d'être un preux, un chevalier dandy, un gentilhomme aux valeurs éternelles, on ne me donne d'autres alternatives que d'aller fréquenter des milieux dans lesquelles je n'aurai d'autres choix que de mentir, de me plier à des raisonnements que je n'approuve pas tout en ayant l'air d'être d'accord. Quoi de plus cynique et de plus immoral?
Quant à l'idée d'engranger de l'argent, il faut être none pour réussir à économiser en étant smicard.
Je finirai par là : évidement le travail et donc la contrainte peuvent être bénéfique puisqu'elle oblige l'homme à se surpasser, et donc à s'élever. Mais chercher la souffrance pour avancer n'est rien d'autre que du masochisme : avoir une bite dans le cul ça fait mal mais ça fait pas marcher droit.
Laissez nous vivre nous les jeunes ou bientôt on vous l'incendiera votre pays de merde.
Et une petite citation de nietzsche, tiré des apologistes du travail :
Dans la glorification du «travail», dans les infatigables discours sur la «bénédiction» du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous : à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent aujourd'hui, à la vue du travail — on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir —, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l'amour et à la haine, il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité : et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême.
na.
jeudi 6 septembre 2007
Le rire
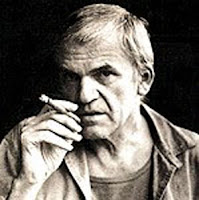
"Rubens eut un jour entre les mains un vieux recueil de photos du président John Kennedy : rien que des photos en couleurs, une cinquantaine au moins, et sur toutes le président riait.
Quelques jours plus tard, il se rendit à Florence. Debout devant le David de Michel-Ange, il se représenta ce visage de marbre aussi hilare que celui de Kennedy. David, ce parangon de la beauté masculine, eut soudain l'air d'un imbécile! Dés lors, il prit l'habitude de plaquer mentalement une bouche rieuse sur les visages des tableaux célèbres ; ce fut une expérimentation intéressante : la grimace du rire était capable de détruire tous les tableaux. Imaginez, au lieu de l'imperceptible sourire de la Joconde, un rire qui lui dénude les dents et les gencives!
Bien que familier des pinacothèques, auxquelles il consacrait l'essentiel de son temps, Rubens avait dû attendre les photos de Kennedy pour se rendre compte de cette simple évidence : depuis l'Antiquité jusqu'à Raphaël, peut-être jusqu'à Ingres, les grands peintres et sculpteurs ont évité de figurer le rire, et même le sourire. Il est vrai que les visages des statues étrusques sont tous souriants, mais ce sourire n'est pas une mimique, une réaction immédiate à une situation, c'est l'état durable du visage rayonnant d'éternelle béatitude. Pour les sculpteurs antiques comme des époques ultérieures, le beau visage n'était pensable que dans son immobilité.
[...]
Mais comment expliquer que les grands peintres aient exclu le rire du royaume de la beauté? Rubens se dit : le visage est beau lorsqu'il reflète la présence d'une pensée, tandis que le moment du rire est un moment où l'on ne pense pas. Mais est ce vrai ? Le rire n'est-il pas cet éclair de réflexion en train de saisir le comique ? Non, se dit Rubens : à l'instant où il saisit le comique, l'homme ne rit pas ; le rire suit immédiatement après, comme une réaction physique comme une convulsion du visage et dans la convulsion l'homme ne se domine pas, étant lui-même dominé par quelque chose qui n'est ni la volonté ni la raison. Voilà pourquoi le sculpteur antique ne représentait pas le rire. L'homme qui ne se domine pas (l'homme au-delà de la raison, au-delà de la volontéà ne pouvait être tenu pour le beau.
Si notre époque, contredisant l'esprit des grands peintres, a fait du rire l'expression favorisée du visage, cela veut dire que l'absence de volonté et de raison est devenue l'état idéal de l'homme. On pourrait objecter que sur les portraits photographiques la compulsion est simulée, donc consciente et voulue : Kennedy riant devant l'objectif d'un photographe ne réagit nullement à une situation comique, mais ouvtre très consciemment la bouche et découvre les dents. Mais cela prouve seulement que la convulsion du rire (l'au-delà de la raison et de la volonté) a été érigée par les hommes d'aujourd'hui en image idéale derrière laquelle ils ont choisi de se cacher.
Rubens pense : le rire est, de toutes les expressions du visage, la plus démocratique : l'immobilité du visage rend clairement discernable chacun des traits qui nous distinguent les uns des autres ; mais dans la convulsion nous sommes tous pareils.
Un buste de Jules César se tordant de rire est impensable. Mais les présidents américains partent pour l'éternité cachés derrière la convulsion démocratique du rire."
extrait de l'immortalité, Milan Kundera
L'art Alexien
mercredi 5 septembre 2007
Le Tigre
J'sens une force indicible, infinie et j'en use avec générosité et jvous méprise, sôts, qui me parlez comme si j'étais un mortel comme vous, un mesquin qui considère les réalités et s'abaisse plus, chaque jour qui passe, à plus de concessions, abandonnant toute la fierté sous prétexte que la vie l'oblige. Vous qui boufferiez votre merde s'il le fallait et diriez même qu'elle est bonne!
Ma force se transforme en rage, je deviens une bombe qui s'auto-censure pour survivre, je suis ligotté, baillonné et ma nature s'est perdue, j'ai perdu mon tigre et chaque jour je retiens mes larmes et je n'peux même pas mourir; le feu ne s'éteind pas, force tranquille, réminiscence d'amour, j'encaisse et sur les ruines je reconstruis au hasard et bientôt non, ignorer ne suffit plus; j'ai plongé dans la masse et perdu mon éclat et ici bas, tout change.
L'enfant sommeil en moi et ne part pas, rêve petit mais pas trop longtemps, le soleil est déjà haut.
Ma force se transforme en rage, je deviens une bombe qui s'auto-censure pour survivre, je suis ligotté, baillonné et ma nature s'est perdue, j'ai perdu mon tigre et chaque jour je retiens mes larmes et je n'peux même pas mourir; le feu ne s'éteind pas, force tranquille, réminiscence d'amour, j'encaisse et sur les ruines je reconstruis au hasard et bientôt non, ignorer ne suffit plus; j'ai plongé dans la masse et perdu mon éclat et ici bas, tout change.
L'enfant sommeil en moi et ne part pas, rêve petit mais pas trop longtemps, le soleil est déjà haut.
Road Trip
Alors c'est un texte que j'ai commencé à écrire sans trop savoir où j'allais. Je n'ai compris qu'un peu plus tard ce que j'avais envie d'exprimer et il y a du coup quelques (beaucoup) maladresses. Néanmoins y'a des choses que j'aime bien, je le post donc même s'il n'est pas finit (le sera t'il un jour?).
Au départ Camill cherche le sens et la connaissance desquels il espère trouver le bonheur. Mais le sens et son côté mathématique, désenchante le monde. La psychologie, la morale, l'intellectualisation de la vie pour ainsi dire, l'oblige à contempler l'existence sous un aspect qui le répugne. Il sombre au fur et à mesure dans une mélancolie qui le rendra presque cynique. Le voyage est une métaphore de son évolution, et les diverses expérience qu'il vivra un prétexte aux découvertes qu'il fera. Il se heurtera au nihilisme, aux désespoir pour en arriver à une forme de révolution : le choix de l'oublie volontaire de ce qu'il a apprit, d'un retour à l'enfance pour ré-appréhender le monde dans ça simplicité. Il se battra alors pour le ré-enchanter, re-créer le sacré en s'appercevant que la connaissance de la vie n'est pas supérieur à la vie elle même.
Le lecteur devrait comprendre que dés le début Camill le savait, puisqu'il cherchait une forme de connaissance instinctive, un rapport direct entre ses émotions et ses perceptions. Il apprendra donc entre autre, au fil de son voyage, qu'il s'y est mal prit. De la connaissance pure il ne trouvera qu'une image triste du monde ; il lui faudra comprendre que la poésie naît du rapport entre l'univers et le corps, et de ses représentations, elles-mêmes imaginées en partie grâce à ses sensations.
Voici l’histoire de Camill L, jeune poète des temps modernes, vagabond itinérant mais bourgeois malgré lui, expérimentateur et expérimenté de la vie, âme rebelle et farfelue qui n'avait de cesse de s'interroger sur ce qui l'entourait. Il semblait vouloir percer le mystère de son existence et du monde, et n'entendait pas abandonner avant d'avoir compris. Le sens, était selon lui indispensable au bonheur, auquel on ne pouvait aboutir qu'en atteignant une forme élevée de connaissance ; tant spirituelle qu'intellectuelle où le sens et l'objet fusionneraient, où l'esprit pénétrerait directement les choses ; où les émotions retranscrirait le monde avec la même exactitude que la vue et le touché.
Sa quête, l'avait amené à se heurter à des énigmes hautement philosophiques sur lesquelles il buttait inlassablement. Il spéculait, alors, imaginant sans arrêts des réponses plausibles, suivait des cheminements douteux et finissait généralement par s'embrouiller. Il est à noter, que malgré la gravité de ses reflexions, Camill n'en était pas moins insouciant. Ce qui pour lui était une chance ; il fréquentait l'absurde de son existence sans en être affecté outre-mesure . Il pouvait errer dans les rues pendant des heures encombré de ses reflections et soudain frivole, s'amuser d'un rien. Il s'adonnait volontier aux péchés véniels, et buvait en vérité plus souvent qu'il n'aurait dû. C'est cet agréable contraste qui lui valu de nombreuses et franches amitiés.
Vagabond, puisqu'il n'habitait nulle part, ce qui lui était un avantage ; changer d'ambiance, de lieu, le distrayait. Le décor, les gens l'inspiraient tant qu'ils ne devenaient pas trop familiers. Vagabond parce que nomade, mais aussi parce qu'il n'avait pas un copec. Bien trop absorbé par la vie qu'il goutaît goûlument et parce qu'incapable de faire quelque chose sans il y trouver un intérêt. Cela viendrait plus tard. Toujours est-il qu'il flirtait avec une forme de liberté qui lui aurait été reprochée s'il n'avait pas été dénué de la moindre parcelle de mesquinerie. Cet air candide et sa joie de vivre lui ouvraient toutes les portes. Avec sa grande carcasse maigrichonne, ses cheveux en bataille et son style accoutumier, on pouvait le prendre pour un rescapé de la Beatnik. Il n'était pas dur d'ailleurs, de se l'imaginer en compagnie de Moriarty, tous deux entrain de divaguer sur des thèmes incertains où pris de folie, de sauter dans une caisse et à fond de cale, se tirer à l'autre bout du pays.
C'était un de ces soirs d'été ou l'air est trop chaud et l'ambiance trop festive pour que le soleil se couche déjà. Entassés dans une vieille citroën, ils discutaient. Où plutôt Bertre, le chauffeur, monologuait, s'excitait de plus en plus à mesure qu'ils avalaient les kilomètres. Il ralait, menaçait, tonitruait qu'il serait un aventurier, qu'il se foutait des gens, surtout de ces filles qui préfèrent les bellâtres, à l'image des acteurs, qui dégainent et exterminent tout dans chaque film, les faisant frémirs, ces nanas en mal de sensations, et rêver les mecs, qui imitaient après, sans s'être aperçu qu'il s'étaient fait castrer pendant ce spectacle viril.. Pendant qu'il vitupérait, Jack ricannait sans jamais donner son avis. Camill derrière, révassait, habitué aux élucubrations de son ami. A sa droite, Mat dormait, comme toujours.
C'est dans cette atmosphère semi-électrique qu'ils voyagaient. Depuis trois jours déjà ils sillonnaient les routes. De Paris, ils étaient descendus par les nationnales, jusqu'à Dijon, pour dévaller la vallée du Rhône jusqu'à Aix en Provence, où ils attrapèrent Mat, et repartirent aussitôt. Ils voulaient longer la méditérannée, traverser la frontière Catalane, rejoindre la Galice, suivre la côte portugaise jusqu'au détroit de Gilbraltar pour sauter jusqu'en terre afriquaine, pleine des promesses d'aventures dont rêvait Bertre. Ils voulaient le désert. Idée qui avait dû être lancée la veille du départ et qui les avaient tous enchantés. Une excursion en plein Sahara, loin des bagnoles, de la pollution, de leur quotidien.
L'évasion par le voyage est la plus saine. C'est en tout cas ce que pensait Camill, qui se taisait depuis leur entrée en Espagne. Il était grave, presque triste ; dans un de ces moments où l'on a une conscience aigüe de soi-même, lucide, ressentant chacun de ses affects avec précisions. Il sentait ses nevroses, ces émotions refoulés qui encombrait sa psychée. Alors qu'il s'imaginait entraint de les percer avec une aiguille, comme si ç'avait été des boules de pues, il fut attiré par la la voix de Bertre qui avait monté d'un cran. Jack, stoïque, subissait ses assauts.
"Bien sur que la vérité existe, disait-il. Ne sommes nous pas tous dans cette voiture en ce moment? Et quand un homme meurt, il est bien mort ; les conclusions ne sont pas difficiles à trouver. C'est faire preuve d'obscurantisme ou de folie que de dire le contraire."
Après cette dernière déclaration il se tut. Le silence dura quelques secondes et Camill, d'une voix monocorde prit la parole :
" Le vrai ! Mais merde à quoi bon ? Le vrai n’existe que pour ceux qui croient en un ordre établit du monde qui limite l’imaginaire alors que c’est l’imaginaire qui crée notre univers et qui l’agrandit! L’imaginaire c’est la fantaisie, la beauté instantanée de notre âme qui s’étale sur notre quotidien aliéné et mesquin !
Et même quand l’âme est noire, c’est beau! L’existence n’existe-elle pas par ses contrastes ?
D'ailleurs, l’aseptisé naît de cette recherche angoissée du vrai, du beau, du divin ; autrement dit, l’homme, à travers sa soif de connaissance, ne cherche qu'à contrôler. Dans sa quête de vérité, il cherche la clé, le concept fondamental et ultime d’où découlent tous les autres ; et bien sur il s’égare : réduisant tout pour mieux voir, il oublie ce qui l’entoure et repeint le monde d’une seule couleur. Comme l’enfant qui rêve, il omet les réalités qui entravent son désir et recrée le monde en oubliant ce qui le dépasse ; le divers et sa beauté, la vie et son grand mystère.. On entre alors dans des schèmes d'où on reste prisonnier. Il n'y a pas de vérité, pas de vérités factuelles.. Elles ne sont elles même, la plupart du temps que des prises de positions. Arrête un peu d'être catégorique, un homme meurt et où elle est ta vérité? Quel enseignemant en tire tu mis à part le fait que tu vas toi même mourir? Il faut voir plus loin ; les représentations de la mort dans nos sociétés sont multiples, tu n'as qu'à imaginer une suite.. "
"Et les maths? demanda Mat qui ne dormait plus.
Personne n'eut le temps de répondre. La voiture s'était mit à faire un drôle de bruit. Soubressaut, hoquet, la panne. Plus d'essence. Ils se garèrent sur le côté, près d'un bosquet de chênes. Bertre bondit de la voiture, ouvrit le coffre, pris un pack de bières, sauta sur le toit et s'assit en tailleur, content ; il avala quelques gorgées et se mit à rire.
"On campe ici"? demanda-t-il hilare.
Mat ne riait pas. Les autres s'en foutaient. "Ici ?" tenta-t-il quand même. Personne ne répondit. Jack et Camill étaient déjà partis reconnaître les lieux. "Attendez moi!" cria-t-il, et il les rejoint.
Mat était de ce genre de gars timide, qu'on oublie facilement. De taille moyenne, toujours sobrement vêtu, il restait silencieux la plupart du temps. C'est d'ailleurs pourquoi il surprenait souvent par des déclarations que personne n'attendait. Toujours attentif, il voyait des choses qui échappaient aux autres. Il passait souvent pour quelqu'un de craintif, de peu de caractère, mais révélait rapidement un subtil mélange; une âme sensible dégageant une aura de force tranquille.
La nuit était tombé maintenant. Ils s'étaient calés autour d'un feu et discutaient de leur périple. Ils faisaient des plans, jouissaient déjà d'être là, libre et sans contraintes. Camill sortit sa guimbarde et se lança dans des impros. Mat, qui était maintenant complètement saoul se mit à parler.
"Il m'arrive de ne plus savoir qui je suis. Dans ces moments, l'angoisse surgit. Je plane dans une forme de brouillard qui me rend amorphe. C'est cette sorte d'état que décrit l'adage, "mais qui suis-je, où vais-je, mais dans quelle était j'erre?!". Mon âme semble s'être arreté en plein désert. Un désert froid et humide. L'énergie à disparu en même temps que mes sensations ; je suis las et triste. Mon corps en suspens, entouré par l'absurde, le sens des choses englouties dans une mélasse grise et vaporeuse. En ces moments, j'ai l'impression de n'être qu'un fantôme flottant au gré des vents d'une imagination devenue lourde et adipeuse.
C'est ma mémoire qui me fait défaut. Les souvenirs disparaissent et font de moi un errant. Je ferme les yeux alors, et je repense ma vie. Je plonge dans le passé, je revis mon histoire. Réminiscence salvatrice. Les émotions oubliées réssurgissent. Je me rappelle, je me souviens de tout. L'enfance, noyau de mon être. L'énergie revient avec l'espoir. Tout s'accélère, se re-précise. Les couleurs reviennent, le brouillard ce dissipe. Je sais qui je suis. Alors j'inspire à nouveau l'air frais de la vie, mon ventre soulagé d'un grand poid."
Il les fit tous frissonner. Jack ricanna. C'est le genre de gars qui se marre quand il ne sait pas comment réagir. Mat reprit la parole.
"Je sais que vous vous demandez pourquoi je vous dis ça. De but en blanc. C'est que je suis bien, que j'ai envie de partager avec vous ce qui me touche. En prenant la route avec vous, j'ai comme l'impression d'avoir arraché ce film de célophane qui me sépare de la vie. Je deviens important, je vois les choses dans leurs détails. C'est une aventure, ma vie, la votre et je sens en moi bouillonner une forme d'espoir, d'audace qui me donne envie de partager nos impressions, d'avancer pour aller plus loin encore, dans la démarche du voyage. Puisque c'est pour ça qu'on voyage n'est ce pas? Parce qu'on est plein d'espoir. Curieux et avide d'aller voir au délà de nos frontières, pour expérimenter ; tout simplement vivre.."
"C'est le moment d'en tirer une conclusion", commença Camill. "L'homme qui ne voyage plus, est un homme déjà mort!"
Ils se turent un moment, pensifs, puis arrosèrent cette découverte métaphysique jusque tard dans la nuit.
Le lendemain il leur fallut bien pourtant régler ce futil mais ennuyeux détail qui les avait bloqué ici : l'essence. Bertre partit en stop avec un bidon, les autres attendait là. Camill lisait, Jack avait sortit sa guitare, Mat dormait. Il revint 2 heures après avec son fût plein. Ils purent repartir vers Pampelune et sa féria. Ils étaient impatients.
Ils arrivèrent tard dans la nuit. La ferveur de la ville les emporta quasi-instantanément dans un délire qui ressemblerait bientôt à une transe mystique. Les rues étaient piétinées par des meutes d'ivrognes qui tournaient dans la ville, dans tous les sens, criaient et chantaient, dansaient parfois, n'oubliant jamais d'aller uriner dans les ruelles les moins fréquentées, qui l'étaient de moins en moins, à cause des odeurs de pisses. Les gens étaient devenus fous, libérés de leurs préoccupations ; enfants spontanés et révoltés, ils hurlaient tous leur amour de la vie, à leur façon, emporté par leur violence, leur rage qui s'était transformé en un amour passionné ; parfois viril mais toujours sincère.
La nuit fut chaotique. Dionysos fut fêter comme seul les espagnols savent le faire. A coup de fûts percés, de chants païens et d'excès en tout genre. Ils se perdirent les uns les autres, dans la foule immense, dispersés et engloutit par des courants contraires. Chacun ressentit cette nuit une fièvre étrange dont ils leurs seraient difficile de parler plus tard.
Camill se reveilla seul, la bouche sèche. Il leva la tête, éblouit par le soleil; assit au milieu d'un rond point. Les mecs qui tournaient autour klaxonnaient en le voyant. Il était couvert de vin, pieds nus, crade comme s'il s'était roulé dans la boue. Qu'est ce qu'il avait bien pu foutre de ses pompes? Il se marra un coup et se leva, se demandant ou pouvait bien être ses potes et comment il allait les retrouver. Il fallait d'abord qu'il avale un truc mais surtout, qu'il boive. Il fouilla ses poches, où il n'y trouva rien d'autre que de la poussière. Merde, pas un rond. Il se leva et se mit à déambuler dans les rues toujours animés, à la recherche d'un point d'eau et peut-être d'une bonne âme qui lui payerait un sandwitch.
La matinée était déjà avancé et sous le soleil, les pavés des ruelles lui brûlait les pieds. Il finit par trouver une fontaine, où flottait quelques canettes vides, vestiges de la nuit passée. Il y but de tout son saoûl et s'assit à l'ombre d'un grand châtaigné pour réfléchir.
Le meilleur moyen de retrouver les autres était de retourner à la voiture. Ce qui n'aurait pas été un problème s'il avait su où il était. Il se remit en route, au hasard, marchant au milieu d'une foule qui enflait à mesure que la journée avançait, évitant quand il le pouvait, les bouses que les taureaux avaient lâché un peu partout en ville. Il tourna pendant deux heures avant de retrouver la voiture. Mat était couché sur le capot, attendant, pensif, tout aussi crotté que Camill, mais avec ses chaussures.
Ils se calèrent à côté, grillant quelques cigarettes en attendant que les autres les rejoignent. Jack arriva un moment plus tard et ils se mirent à piailler, se racontant leurs soirées, cherchant à renouer les bribes de souvenirs qu'ils leur restaient. Ils étaient bien. Un peu stone, envoûter par les bambocheurs excités qui passaient devant eux, et par la ville qui recommençait à s'exalter.
C'était déjà la fin d'après midi et Bertre ne revenait toujours pas. Ils étaient patients, mais ça commençait à devenir long.
"Bon, dit Jack, je vais chercher de l'alcool. Bougez pas, dans 15 minutes je suis là et on se la met."
"Mais t'as des thunes?" demanda Mat.
"Non, tout est dans la caisse, mais j'ai copiné avec des types qui ont un bar ici, ils nous lâcheront bien une bouteille de sangria. Ce sera pas le nirvana mais j'ai rien d'autre à proposer."
Les autres ne répondant pas, il partit s'enquérir de son breuvage.
La soirée s'amorça donc sans nouvelle de Bertre, ce qui ne les inquiéta pas le premier soir. Ils burent et l'oublièrent, pris dans la tempête nocturne. Ils restèrent ensemble cette nuit là. Jack, se promenait avec un baton sur lequel il gravait une encoche, à chaque fille qu'il embrassait. Ce qui faisait sourire Camill ; qui ne connaissait pas de meilleur dragueur. En ces moments, il se métamorphosait : son regard devenait doux, son visage enfantin, presque angélique. Il s'avançait vers elles, comme si c'était plus fort que lui, aimanté, ce qui devaient les persuader de l'attrait mystique qu'elles avaient sur lui. Il leur murmurait des choses à l'oreille, les touchait, et les calinait sans qu'elles n'opposent de résistances puis les embrassait généralement avant qu'on y est compris quelque chose. Ca relevait du génie.
Mat avait une technique toute différente. Il s'asseyait à côté d'une fille qu'il avait choisit et lui parlait longuement. On le voyait alors s'animer, devenir éloquent, presque expressif. Et quant il arrivait à ses fins, on le voyait revenir le lendemain, transfiguré, encore plus silencieux que d'habitude, mais un sourire immense qui ne le quittait pas avant un bon moment.
Camill ne draguait pas. Il semblait se suffir à lui même. C'est qu'il considérait l'amour comme une illusion. Un substitut à la solitude. Une passion construite sur des objets crystalisés, qui se terminait presque toujours par de la frustration, de la souffrance et du ressentiment ; un cercle vicieux qui n'avait de cesse que le jour ou, lassés par cette quête chaotique, les instigateurs de l'amour abandonnent peu à peu leurs idéaux si haut placés, se résignent à la concession, à aimer moins follement, mais plus longuement.
Le lendemain ils passèrent encore leur journée près de la voiture. Bertre ne revenait toujours pas, et ils commençaient à s'inquiéter. Ils fallait le retrouver. Jack devait rester près de la voiture, au cas ou il reviendrait, pendant que Camill et Mat partaient faire le tour des infirmeries.
C'est finalement à l'hôpital qu'ils le retrouvèrent. Il s'était fait encorner pendant l'Encierro. Rien de grave mais il était cloué au lit pendant une bonne semaine. Ce qui le déprimait profondément.
"T'inquiète pas Bertre, dit Jack, l'été est encore long, et on à le temps de voir. Toi tu restes au pieu, nous on fait les férias, on te récupère quand on aura besoin d'un chauffeur."
"Bande d'enfoirés, répondit-il."
Et ils se marrèrent.
Au départ Camill cherche le sens et la connaissance desquels il espère trouver le bonheur. Mais le sens et son côté mathématique, désenchante le monde. La psychologie, la morale, l'intellectualisation de la vie pour ainsi dire, l'oblige à contempler l'existence sous un aspect qui le répugne. Il sombre au fur et à mesure dans une mélancolie qui le rendra presque cynique. Le voyage est une métaphore de son évolution, et les diverses expérience qu'il vivra un prétexte aux découvertes qu'il fera. Il se heurtera au nihilisme, aux désespoir pour en arriver à une forme de révolution : le choix de l'oublie volontaire de ce qu'il a apprit, d'un retour à l'enfance pour ré-appréhender le monde dans ça simplicité. Il se battra alors pour le ré-enchanter, re-créer le sacré en s'appercevant que la connaissance de la vie n'est pas supérieur à la vie elle même.
Le lecteur devrait comprendre que dés le début Camill le savait, puisqu'il cherchait une forme de connaissance instinctive, un rapport direct entre ses émotions et ses perceptions. Il apprendra donc entre autre, au fil de son voyage, qu'il s'y est mal prit. De la connaissance pure il ne trouvera qu'une image triste du monde ; il lui faudra comprendre que la poésie naît du rapport entre l'univers et le corps, et de ses représentations, elles-mêmes imaginées en partie grâce à ses sensations.
Partie 1
Voici l’histoire de Camill L, jeune poète des temps modernes, vagabond itinérant mais bourgeois malgré lui, expérimentateur et expérimenté de la vie, âme rebelle et farfelue qui n'avait de cesse de s'interroger sur ce qui l'entourait. Il semblait vouloir percer le mystère de son existence et du monde, et n'entendait pas abandonner avant d'avoir compris. Le sens, était selon lui indispensable au bonheur, auquel on ne pouvait aboutir qu'en atteignant une forme élevée de connaissance ; tant spirituelle qu'intellectuelle où le sens et l'objet fusionneraient, où l'esprit pénétrerait directement les choses ; où les émotions retranscrirait le monde avec la même exactitude que la vue et le touché.
Sa quête, l'avait amené à se heurter à des énigmes hautement philosophiques sur lesquelles il buttait inlassablement. Il spéculait, alors, imaginant sans arrêts des réponses plausibles, suivait des cheminements douteux et finissait généralement par s'embrouiller. Il est à noter, que malgré la gravité de ses reflexions, Camill n'en était pas moins insouciant. Ce qui pour lui était une chance ; il fréquentait l'absurde de son existence sans en être affecté outre-mesure . Il pouvait errer dans les rues pendant des heures encombré de ses reflections et soudain frivole, s'amuser d'un rien. Il s'adonnait volontier aux péchés véniels, et buvait en vérité plus souvent qu'il n'aurait dû. C'est cet agréable contraste qui lui valu de nombreuses et franches amitiés.
Vagabond, puisqu'il n'habitait nulle part, ce qui lui était un avantage ; changer d'ambiance, de lieu, le distrayait. Le décor, les gens l'inspiraient tant qu'ils ne devenaient pas trop familiers. Vagabond parce que nomade, mais aussi parce qu'il n'avait pas un copec. Bien trop absorbé par la vie qu'il goutaît goûlument et parce qu'incapable de faire quelque chose sans il y trouver un intérêt. Cela viendrait plus tard. Toujours est-il qu'il flirtait avec une forme de liberté qui lui aurait été reprochée s'il n'avait pas été dénué de la moindre parcelle de mesquinerie. Cet air candide et sa joie de vivre lui ouvraient toutes les portes. Avec sa grande carcasse maigrichonne, ses cheveux en bataille et son style accoutumier, on pouvait le prendre pour un rescapé de la Beatnik. Il n'était pas dur d'ailleurs, de se l'imaginer en compagnie de Moriarty, tous deux entrain de divaguer sur des thèmes incertains où pris de folie, de sauter dans une caisse et à fond de cale, se tirer à l'autre bout du pays.
***
C'était un de ces soirs d'été ou l'air est trop chaud et l'ambiance trop festive pour que le soleil se couche déjà. Entassés dans une vieille citroën, ils discutaient. Où plutôt Bertre, le chauffeur, monologuait, s'excitait de plus en plus à mesure qu'ils avalaient les kilomètres. Il ralait, menaçait, tonitruait qu'il serait un aventurier, qu'il se foutait des gens, surtout de ces filles qui préfèrent les bellâtres, à l'image des acteurs, qui dégainent et exterminent tout dans chaque film, les faisant frémirs, ces nanas en mal de sensations, et rêver les mecs, qui imitaient après, sans s'être aperçu qu'il s'étaient fait castrer pendant ce spectacle viril.. Pendant qu'il vitupérait, Jack ricannait sans jamais donner son avis. Camill derrière, révassait, habitué aux élucubrations de son ami. A sa droite, Mat dormait, comme toujours.
C'est dans cette atmosphère semi-électrique qu'ils voyagaient. Depuis trois jours déjà ils sillonnaient les routes. De Paris, ils étaient descendus par les nationnales, jusqu'à Dijon, pour dévaller la vallée du Rhône jusqu'à Aix en Provence, où ils attrapèrent Mat, et repartirent aussitôt. Ils voulaient longer la méditérannée, traverser la frontière Catalane, rejoindre la Galice, suivre la côte portugaise jusqu'au détroit de Gilbraltar pour sauter jusqu'en terre afriquaine, pleine des promesses d'aventures dont rêvait Bertre. Ils voulaient le désert. Idée qui avait dû être lancée la veille du départ et qui les avaient tous enchantés. Une excursion en plein Sahara, loin des bagnoles, de la pollution, de leur quotidien.
L'évasion par le voyage est la plus saine. C'est en tout cas ce que pensait Camill, qui se taisait depuis leur entrée en Espagne. Il était grave, presque triste ; dans un de ces moments où l'on a une conscience aigüe de soi-même, lucide, ressentant chacun de ses affects avec précisions. Il sentait ses nevroses, ces émotions refoulés qui encombrait sa psychée. Alors qu'il s'imaginait entraint de les percer avec une aiguille, comme si ç'avait été des boules de pues, il fut attiré par la la voix de Bertre qui avait monté d'un cran. Jack, stoïque, subissait ses assauts.
"Bien sur que la vérité existe, disait-il. Ne sommes nous pas tous dans cette voiture en ce moment? Et quand un homme meurt, il est bien mort ; les conclusions ne sont pas difficiles à trouver. C'est faire preuve d'obscurantisme ou de folie que de dire le contraire."
Après cette dernière déclaration il se tut. Le silence dura quelques secondes et Camill, d'une voix monocorde prit la parole :
" Le vrai ! Mais merde à quoi bon ? Le vrai n’existe que pour ceux qui croient en un ordre établit du monde qui limite l’imaginaire alors que c’est l’imaginaire qui crée notre univers et qui l’agrandit! L’imaginaire c’est la fantaisie, la beauté instantanée de notre âme qui s’étale sur notre quotidien aliéné et mesquin !
Et même quand l’âme est noire, c’est beau! L’existence n’existe-elle pas par ses contrastes ?
D'ailleurs, l’aseptisé naît de cette recherche angoissée du vrai, du beau, du divin ; autrement dit, l’homme, à travers sa soif de connaissance, ne cherche qu'à contrôler. Dans sa quête de vérité, il cherche la clé, le concept fondamental et ultime d’où découlent tous les autres ; et bien sur il s’égare : réduisant tout pour mieux voir, il oublie ce qui l’entoure et repeint le monde d’une seule couleur. Comme l’enfant qui rêve, il omet les réalités qui entravent son désir et recrée le monde en oubliant ce qui le dépasse ; le divers et sa beauté, la vie et son grand mystère.. On entre alors dans des schèmes d'où on reste prisonnier. Il n'y a pas de vérité, pas de vérités factuelles.. Elles ne sont elles même, la plupart du temps que des prises de positions. Arrête un peu d'être catégorique, un homme meurt et où elle est ta vérité? Quel enseignemant en tire tu mis à part le fait que tu vas toi même mourir? Il faut voir plus loin ; les représentations de la mort dans nos sociétés sont multiples, tu n'as qu'à imaginer une suite.. "
"Et les maths? demanda Mat qui ne dormait plus.
Personne n'eut le temps de répondre. La voiture s'était mit à faire un drôle de bruit. Soubressaut, hoquet, la panne. Plus d'essence. Ils se garèrent sur le côté, près d'un bosquet de chênes. Bertre bondit de la voiture, ouvrit le coffre, pris un pack de bières, sauta sur le toit et s'assit en tailleur, content ; il avala quelques gorgées et se mit à rire.
"On campe ici"? demanda-t-il hilare.
Mat ne riait pas. Les autres s'en foutaient. "Ici ?" tenta-t-il quand même. Personne ne répondit. Jack et Camill étaient déjà partis reconnaître les lieux. "Attendez moi!" cria-t-il, et il les rejoint.
Mat était de ce genre de gars timide, qu'on oublie facilement. De taille moyenne, toujours sobrement vêtu, il restait silencieux la plupart du temps. C'est d'ailleurs pourquoi il surprenait souvent par des déclarations que personne n'attendait. Toujours attentif, il voyait des choses qui échappaient aux autres. Il passait souvent pour quelqu'un de craintif, de peu de caractère, mais révélait rapidement un subtil mélange; une âme sensible dégageant une aura de force tranquille.
La nuit était tombé maintenant. Ils s'étaient calés autour d'un feu et discutaient de leur périple. Ils faisaient des plans, jouissaient déjà d'être là, libre et sans contraintes. Camill sortit sa guimbarde et se lança dans des impros. Mat, qui était maintenant complètement saoul se mit à parler.
"Il m'arrive de ne plus savoir qui je suis. Dans ces moments, l'angoisse surgit. Je plane dans une forme de brouillard qui me rend amorphe. C'est cette sorte d'état que décrit l'adage, "mais qui suis-je, où vais-je, mais dans quelle était j'erre?!". Mon âme semble s'être arreté en plein désert. Un désert froid et humide. L'énergie à disparu en même temps que mes sensations ; je suis las et triste. Mon corps en suspens, entouré par l'absurde, le sens des choses englouties dans une mélasse grise et vaporeuse. En ces moments, j'ai l'impression de n'être qu'un fantôme flottant au gré des vents d'une imagination devenue lourde et adipeuse.
C'est ma mémoire qui me fait défaut. Les souvenirs disparaissent et font de moi un errant. Je ferme les yeux alors, et je repense ma vie. Je plonge dans le passé, je revis mon histoire. Réminiscence salvatrice. Les émotions oubliées réssurgissent. Je me rappelle, je me souviens de tout. L'enfance, noyau de mon être. L'énergie revient avec l'espoir. Tout s'accélère, se re-précise. Les couleurs reviennent, le brouillard ce dissipe. Je sais qui je suis. Alors j'inspire à nouveau l'air frais de la vie, mon ventre soulagé d'un grand poid."
Il les fit tous frissonner. Jack ricanna. C'est le genre de gars qui se marre quand il ne sait pas comment réagir. Mat reprit la parole.
"Je sais que vous vous demandez pourquoi je vous dis ça. De but en blanc. C'est que je suis bien, que j'ai envie de partager avec vous ce qui me touche. En prenant la route avec vous, j'ai comme l'impression d'avoir arraché ce film de célophane qui me sépare de la vie. Je deviens important, je vois les choses dans leurs détails. C'est une aventure, ma vie, la votre et je sens en moi bouillonner une forme d'espoir, d'audace qui me donne envie de partager nos impressions, d'avancer pour aller plus loin encore, dans la démarche du voyage. Puisque c'est pour ça qu'on voyage n'est ce pas? Parce qu'on est plein d'espoir. Curieux et avide d'aller voir au délà de nos frontières, pour expérimenter ; tout simplement vivre.."
"C'est le moment d'en tirer une conclusion", commença Camill. "L'homme qui ne voyage plus, est un homme déjà mort!"
Ils se turent un moment, pensifs, puis arrosèrent cette découverte métaphysique jusque tard dans la nuit.
Le lendemain il leur fallut bien pourtant régler ce futil mais ennuyeux détail qui les avait bloqué ici : l'essence. Bertre partit en stop avec un bidon, les autres attendait là. Camill lisait, Jack avait sortit sa guitare, Mat dormait. Il revint 2 heures après avec son fût plein. Ils purent repartir vers Pampelune et sa féria. Ils étaient impatients.
Ils arrivèrent tard dans la nuit. La ferveur de la ville les emporta quasi-instantanément dans un délire qui ressemblerait bientôt à une transe mystique. Les rues étaient piétinées par des meutes d'ivrognes qui tournaient dans la ville, dans tous les sens, criaient et chantaient, dansaient parfois, n'oubliant jamais d'aller uriner dans les ruelles les moins fréquentées, qui l'étaient de moins en moins, à cause des odeurs de pisses. Les gens étaient devenus fous, libérés de leurs préoccupations ; enfants spontanés et révoltés, ils hurlaient tous leur amour de la vie, à leur façon, emporté par leur violence, leur rage qui s'était transformé en un amour passionné ; parfois viril mais toujours sincère.
La nuit fut chaotique. Dionysos fut fêter comme seul les espagnols savent le faire. A coup de fûts percés, de chants païens et d'excès en tout genre. Ils se perdirent les uns les autres, dans la foule immense, dispersés et engloutit par des courants contraires. Chacun ressentit cette nuit une fièvre étrange dont ils leurs seraient difficile de parler plus tard.
***
Camill se reveilla seul, la bouche sèche. Il leva la tête, éblouit par le soleil; assit au milieu d'un rond point. Les mecs qui tournaient autour klaxonnaient en le voyant. Il était couvert de vin, pieds nus, crade comme s'il s'était roulé dans la boue. Qu'est ce qu'il avait bien pu foutre de ses pompes? Il se marra un coup et se leva, se demandant ou pouvait bien être ses potes et comment il allait les retrouver. Il fallait d'abord qu'il avale un truc mais surtout, qu'il boive. Il fouilla ses poches, où il n'y trouva rien d'autre que de la poussière. Merde, pas un rond. Il se leva et se mit à déambuler dans les rues toujours animés, à la recherche d'un point d'eau et peut-être d'une bonne âme qui lui payerait un sandwitch.
La matinée était déjà avancé et sous le soleil, les pavés des ruelles lui brûlait les pieds. Il finit par trouver une fontaine, où flottait quelques canettes vides, vestiges de la nuit passée. Il y but de tout son saoûl et s'assit à l'ombre d'un grand châtaigné pour réfléchir.
Le meilleur moyen de retrouver les autres était de retourner à la voiture. Ce qui n'aurait pas été un problème s'il avait su où il était. Il se remit en route, au hasard, marchant au milieu d'une foule qui enflait à mesure que la journée avançait, évitant quand il le pouvait, les bouses que les taureaux avaient lâché un peu partout en ville. Il tourna pendant deux heures avant de retrouver la voiture. Mat était couché sur le capot, attendant, pensif, tout aussi crotté que Camill, mais avec ses chaussures.
Ils se calèrent à côté, grillant quelques cigarettes en attendant que les autres les rejoignent. Jack arriva un moment plus tard et ils se mirent à piailler, se racontant leurs soirées, cherchant à renouer les bribes de souvenirs qu'ils leur restaient. Ils étaient bien. Un peu stone, envoûter par les bambocheurs excités qui passaient devant eux, et par la ville qui recommençait à s'exalter.
C'était déjà la fin d'après midi et Bertre ne revenait toujours pas. Ils étaient patients, mais ça commençait à devenir long.
"Bon, dit Jack, je vais chercher de l'alcool. Bougez pas, dans 15 minutes je suis là et on se la met."
"Mais t'as des thunes?" demanda Mat.
"Non, tout est dans la caisse, mais j'ai copiné avec des types qui ont un bar ici, ils nous lâcheront bien une bouteille de sangria. Ce sera pas le nirvana mais j'ai rien d'autre à proposer."
Les autres ne répondant pas, il partit s'enquérir de son breuvage.
La soirée s'amorça donc sans nouvelle de Bertre, ce qui ne les inquiéta pas le premier soir. Ils burent et l'oublièrent, pris dans la tempête nocturne. Ils restèrent ensemble cette nuit là. Jack, se promenait avec un baton sur lequel il gravait une encoche, à chaque fille qu'il embrassait. Ce qui faisait sourire Camill ; qui ne connaissait pas de meilleur dragueur. En ces moments, il se métamorphosait : son regard devenait doux, son visage enfantin, presque angélique. Il s'avançait vers elles, comme si c'était plus fort que lui, aimanté, ce qui devaient les persuader de l'attrait mystique qu'elles avaient sur lui. Il leur murmurait des choses à l'oreille, les touchait, et les calinait sans qu'elles n'opposent de résistances puis les embrassait généralement avant qu'on y est compris quelque chose. Ca relevait du génie.
Mat avait une technique toute différente. Il s'asseyait à côté d'une fille qu'il avait choisit et lui parlait longuement. On le voyait alors s'animer, devenir éloquent, presque expressif. Et quant il arrivait à ses fins, on le voyait revenir le lendemain, transfiguré, encore plus silencieux que d'habitude, mais un sourire immense qui ne le quittait pas avant un bon moment.
Camill ne draguait pas. Il semblait se suffir à lui même. C'est qu'il considérait l'amour comme une illusion. Un substitut à la solitude. Une passion construite sur des objets crystalisés, qui se terminait presque toujours par de la frustration, de la souffrance et du ressentiment ; un cercle vicieux qui n'avait de cesse que le jour ou, lassés par cette quête chaotique, les instigateurs de l'amour abandonnent peu à peu leurs idéaux si haut placés, se résignent à la concession, à aimer moins follement, mais plus longuement.
Le lendemain ils passèrent encore leur journée près de la voiture. Bertre ne revenait toujours pas, et ils commençaient à s'inquiéter. Ils fallait le retrouver. Jack devait rester près de la voiture, au cas ou il reviendrait, pendant que Camill et Mat partaient faire le tour des infirmeries.
C'est finalement à l'hôpital qu'ils le retrouvèrent. Il s'était fait encorner pendant l'Encierro. Rien de grave mais il était cloué au lit pendant une bonne semaine. Ce qui le déprimait profondément.
"T'inquiète pas Bertre, dit Jack, l'été est encore long, et on à le temps de voir. Toi tu restes au pieu, nous on fait les férias, on te récupère quand on aura besoin d'un chauffeur."
"Bande d'enfoirés, répondit-il."
Et ils se marrèrent.
spéculation
C'est en marchant rue Saint Rome, au retour d'une dure après-midi de labeur que m'est venue une pensée. Sans grand intéret, mais qui m'a amusé.
Je ne me souviens plus très bien d'où je suis parti. Ca à commencer par un dialogue entre deux personnes, qui à débuter, je crois, comme ça :
_ Il y a bien plus de gens que d'idées. En fait, on peut même dire qu'il y en a peu. Elles circulent, elles voyages mais se sont toujours les mêmes.
_ C'est idiot. Comment peux-tu ne pas penser à l'histoire de la pensée humaine? Les idées ne circulent pas simplement, elles évoluent. Certes beaucoup de personnes n'inventent rien et s'accaparent concepts, valeurs, pensées pré- fabriquées, mais il y en a sans cesse de nouvelles. Sinon nous en serions encore à l'âge de pierre.
_ Peut-être. Mais je pense à cette loi physique qui dit, rien ne se crée, tout se tranforme. Finalement, si on applique cette théorie à la pensée, nous n'inventerions jamais rien, mais transformerions sans cesse.
Les plus grands penseurs seraient donc les plus fins alchimistes.
Puis j'ai pensé à autre chose.. ( me semblait vachement plus longue, ma reflexion, avant que je l'écrive ^_^ )
Je ne me souviens plus très bien d'où je suis parti. Ca à commencer par un dialogue entre deux personnes, qui à débuter, je crois, comme ça :
_ Il y a bien plus de gens que d'idées. En fait, on peut même dire qu'il y en a peu. Elles circulent, elles voyages mais se sont toujours les mêmes.
_ C'est idiot. Comment peux-tu ne pas penser à l'histoire de la pensée humaine? Les idées ne circulent pas simplement, elles évoluent. Certes beaucoup de personnes n'inventent rien et s'accaparent concepts, valeurs, pensées pré- fabriquées, mais il y en a sans cesse de nouvelles. Sinon nous en serions encore à l'âge de pierre.
_ Peut-être. Mais je pense à cette loi physique qui dit, rien ne se crée, tout se tranforme. Finalement, si on applique cette théorie à la pensée, nous n'inventerions jamais rien, mais transformerions sans cesse.
Les plus grands penseurs seraient donc les plus fins alchimistes.
Puis j'ai pensé à autre chose.. ( me semblait vachement plus longue, ma reflexion, avant que je l'écrive ^_^ )
Kundera
Le petit conseil du jour :
"Le maniement de la pensée féminine a ses règles inflexibles ; celui qui se met en tête de persuader une femme, de réfuter son point de vue à coups de bonnes raisons, a peu de chances d'aboutir. Il est bien plus judicieux de repérer l'image qu'elle veut donner d'elle-même (ses principes, idéaux, convictions), puis d'essayer d'établir (par sophismes) un rapport harmonieux entre ladite image et la conduite que nous souhaitons lui voir tenir."
"Le maniement de la pensée féminine a ses règles inflexibles ; celui qui se met en tête de persuader une femme, de réfuter son point de vue à coups de bonnes raisons, a peu de chances d'aboutir. Il est bien plus judicieux de repérer l'image qu'elle veut donner d'elle-même (ses principes, idéaux, convictions), puis d'essayer d'établir (par sophismes) un rapport harmonieux entre ladite image et la conduite que nous souhaitons lui voir tenir."
lundi 3 septembre 2007
L'arbuste - poésie chaotique
Je me couche tard,
Je me lève tard,
Je reste cloitré ;
J'attends.
Je n'ai pas peur
La vie me tente
Je peux la sentir couler dans mes veines
En moi.
Je l'imagine souvent,
En tout ce qu'elle regorge d'expérience, d'aspérités et de richesses.
Ce n'est pas l'incohérence
Ni la souffrance
L'absurde de l'existence pour ainsi dire, qui me rend inactif ;
C'est que j'ai beau la pressentir,
Elle m'échappe sans arrêt.
Je me roule dans l'herbe
Me vautre dans la boue
Je ne veux faire plus qu'un avec elle
Et une transe désespérée commence,
Un flirt avec la terre, qui finit toujours le visage tendu vers le ciel noir étoilé
Où je me perds ;
Je rigole.
Mon corps pense pour moi
J'éprouve les âges
Adrénaline.
Je me sens asticot
Ca m'excite
Dieu m'écœure
Trop facile..
Je veux errer dans les bas fonds.
Nager dans l'épaisseur, le contraste.
J'ai les yeux secs ;
Monde aseptisé
Femmes stérilisées et
Barbus castrés.
L'aventure est perdue!
**
Je n'ai pas de tronc,
Arbre chétif aux nombreuses ramures,
Eparpillé,
dispersé.
Arbuste schizophrène plaqué à son tendeur :
Orbe d'énergie.
Artifice!
Je défie les grands chênes et même les baobabs ;
Gerbe de lumière, je brille et j'éblouis !
Feu de paille !
Branches trop frêles, tombent incandescentes et brûlent mes racines..
La sève coule,
mon âme pleure,
l'arbre s'affaisse.
L'aura disparaît avec l'illusion ; broussaille rabougrie et contrite.
Ils rient les chênes.
Je me lève tard,
Je reste cloitré ;
J'attends.
Je n'ai pas peur
La vie me tente
Je peux la sentir couler dans mes veines
En moi.
Je l'imagine souvent,
En tout ce qu'elle regorge d'expérience, d'aspérités et de richesses.
Ce n'est pas l'incohérence
Ni la souffrance
L'absurde de l'existence pour ainsi dire, qui me rend inactif ;
C'est que j'ai beau la pressentir,
Elle m'échappe sans arrêt.
Je me roule dans l'herbe
Me vautre dans la boue
Je ne veux faire plus qu'un avec elle
Et une transe désespérée commence,
Un flirt avec la terre, qui finit toujours le visage tendu vers le ciel noir étoilé
Où je me perds ;
Je rigole.
Mon corps pense pour moi
J'éprouve les âges
Adrénaline.
Je me sens asticot
Ca m'excite
Dieu m'écœure
Trop facile..
Je veux errer dans les bas fonds.
Nager dans l'épaisseur, le contraste.
J'ai les yeux secs ;
Monde aseptisé
Femmes stérilisées et
Barbus castrés.
L'aventure est perdue!
**
Je n'ai pas de tronc,
Arbre chétif aux nombreuses ramures,
Eparpillé,
dispersé.
Arbuste schizophrène plaqué à son tendeur :
Orbe d'énergie.
Artifice!
Je défie les grands chênes et même les baobabs ;
Gerbe de lumière, je brille et j'éblouis !
Feu de paille !
Branches trop frêles, tombent incandescentes et brûlent mes racines..
La sève coule,
mon âme pleure,
l'arbre s'affaisse.
L'aura disparaît avec l'illusion ; broussaille rabougrie et contrite.
Ils rient les chênes.
Un fantasme se réalise.
Ces fameux blogs, j'en aurai entendu parler. Et voilà que moi aussi je m'y mets. C'est que bientôt je pars en Australie, et il faudra bien partager un peu les expériences palpitantes qui m'attendent. En attendant il s'agit de parler de mes états d'âme, puisque si j'ai bien compris le but d'un blog est d'étaler à la vu de tous une partie de sa vie. Où du moins de projeter une image sous contrôle à laquelle on s'identifie et qui se veut costume, emblème de soi-même. Un attribut du"Moi" pour ainsi dire.
Le fait est que j'ai une infinité de choses à dire. Et un besoin de les crier à tue-tête. Paradoxe étrange puisqu'il me semble que la quête qui m'habite serait plutôt la démarche inverse : c'est à dire de soustraire à mon "Moi" tout attribut inutile, tentant d'atteindre la génèse de mon âme, dans l'espoir de pouvoir répondre à la grande question : "mais qui suis-je?"
J'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que tant qu'on est soumis à ce besoin de se faire valoir, c'est à dire, dépendant du jugement des autres et soumis à leurs raisons, il est impossible d'atteindre la liberté ; la liberté d'être sincère et donc de s'éloigner sensiblement de la substance de son âme. Une trahison en somme.
Le paradoxe, c'est qu'il est impensable d'exister sans les autres. Que c'est par les gens qu'on peut se situer, que c'est eux qui nous façonnent. La quintessence de l'âme est une douce chimère. Il suffit d'ailleurs de faire un peu de sciences humaines pour s'en rendre compte : à priori l'homme est déterminé, et le "Moi" n'est qu'une série de transformations que forment les conflits psychiques, l'enfant du "ça" et du monde extérieurs - de ses règles.
En clair, le "Moi" est poreux, et l'introspection intensive nous place invariablement devant l'ambivalence de nos désirs.
D'où ce blog.
Le fait est que j'ai une infinité de choses à dire. Et un besoin de les crier à tue-tête. Paradoxe étrange puisqu'il me semble que la quête qui m'habite serait plutôt la démarche inverse : c'est à dire de soustraire à mon "Moi" tout attribut inutile, tentant d'atteindre la génèse de mon âme, dans l'espoir de pouvoir répondre à la grande question : "mais qui suis-je?"
J'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que tant qu'on est soumis à ce besoin de se faire valoir, c'est à dire, dépendant du jugement des autres et soumis à leurs raisons, il est impossible d'atteindre la liberté ; la liberté d'être sincère et donc de s'éloigner sensiblement de la substance de son âme. Une trahison en somme.
Le paradoxe, c'est qu'il est impensable d'exister sans les autres. Que c'est par les gens qu'on peut se situer, que c'est eux qui nous façonnent. La quintessence de l'âme est une douce chimère. Il suffit d'ailleurs de faire un peu de sciences humaines pour s'en rendre compte : à priori l'homme est déterminé, et le "Moi" n'est qu'une série de transformations que forment les conflits psychiques, l'enfant du "ça" et du monde extérieurs - de ses règles.
En clair, le "Moi" est poreux, et l'introspection intensive nous place invariablement devant l'ambivalence de nos désirs.
D'où ce blog.
Inscription à :
Articles (Atom)

